01/02/2012
François Hollande et le monde des affaires

« En choisissant comme directeur de campagne le vice-président du Cercle de l’Industrie – lobby réunissant les PDG des principaux groupes industriels français – le candidat de la gauche de droite aux prochaines élections présidentielles a envoyé un signal, on ne peut plus clair, aux marchés financiers : l’alternance ne constituera pas une menace, bien au contraire, pour les classes possédantes. Après José Sócrates, José Luis Zapatero, George Papandréou et Elio Di Rupo, François Hollande sera-t-il le prochain dirigeant socialiste à prétexter la "crise des dettes publiques" pour imposer aux travailleurs l’austérité et la régression sociale ? Au vu du pédigrée de ses responsables de campagne, il y a tout lieu de le craindre : c’est que les principaux conseillers dudit candidat se signalent par leur proximité avec le monde des affaires et leur volonté de rassurer l’Europe des marchés. A moins de quatre mois des élections, un passage en revue des troupes s’imposait.
16:07 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Politique, Propagande, Stratégie | Lien permanent | Tags : françois hollande, équipe de campagne, conseillers, monde des affaires, pierre moscovici, cercle de l'industrie, medef, cac 40, michel sapin, économistes, médias, capitalisme | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
30/01/2012
Ignorer la Presse-Pravda
En complément, cet article de Robert Fisk dans The Independent :
« Revenir sur des histoires passées est une des tâches les plus difficiles dans le journalisme - et particulièrement dans le cas de l’Iran.
L’Iran, la sombre menace islamiste révolutionnaire... L’Iran chiite, protecteur et manipulateur de la Terreur mondiale, de la Syrie et du Liban, et du Hamas, et du Hezbollah... Ahmadinejad, le Calife fou... Et, bien sûr, l’Iran nucléaire, se préparant à détruire Israël dans un nuage de champignon atomique fait de haine antisémite, prêt à fermer le détroit d’Ormuz au moment où les forces de l’Occident (ou d’Israël) l’attaqueront...
Étant donné la nature du régime théocratique, la répression hautement condamnable contre ses adversaires après les élections de 2009 [...] toute tentative d’injecter du sens commun dans l’histoire doit être précédée d’une formule protectrice : non, bien sûr l’Iran n’est pas un endroit agréable. Mais...
Prenons la version israélienne qui - malgré les preuves à foison que les services de renseignement d’Israël sont à peu près aussi efficaces que ceux de la Syrie - continue à être claironnée par ses amis en Occident dont aucun n’est plus servile que les journalistes des médias occidentaux. Le président israélien nous avertit aujourd’hui que l’Iran est sur le point de produire une arme nucléaire. Le ciel nous en préserve. Pourtant, nous journalistes, évitons de mentionner que Shimon Peres, le Premier ministre israélien, a dit exactement la même chose en 1996. C’était il y a de cela 16 ans... Et évitons de rappeler que le Premier ministre israélien actuel, Benjamin Netanyahu, avait déclaré en 1992 que l’Iran aurait la bombe nucléaire d’ici 1999. C’était il y a 13 ans. Toujours la même vieille histoire.
En fait, nous ne savons pas si l’Iran est vraiment en train de mettre au point une arme nucléaire. Et après l’affaire irakienne, il est étonnant que ces vieux détails sur des armes des destruction massive surgissent à la même fréquence que toutes ces balivernes sur l’arsenal titanesque de Saddam Hussein.
23:47 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Géopolitique, Politique, Propagande, Psychologie, Stratégie | Lien permanent | Tags : médias, etats-unis, guerre, armes de destruction massive, irak, iran, guerres mondiales, désinformation, fabrication d'événements, paul craig roberts, james corbett, robert fisk | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
26/01/2012
Pierre Conesa sur la fabrication de l'ennemi
Pierre Conesa, chercheur associé à l'IRIS, ancien directeur adjoint de la délégation aux Affaires stratégiques du Ministère de la Défense, est l'auteur de « La fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi » (Robert Laffont, 2011).
Dans la troisième vidéo, un débat avec Aymeric Chauprade.
00:24 Écrit par Boreas dans Géopolitique, Politique, Propagande, Stratégie | Lien permanent | Tags : pierre conesa, fabrication, ennemi, etats-unis, europe, iran, aymeric chauprade | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
14/01/2012
« La cote de confiance des partis politiques est de 12% en France »
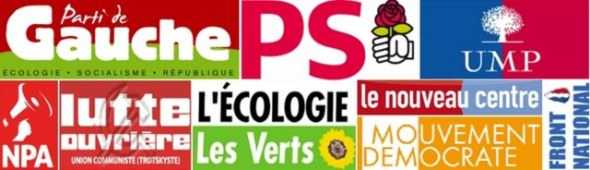
Soldes. Dernière démarque.
C'est avec un peu de retard, via le site Polémia, que je découvre cette donnée sensationnelle, collectée par l'agence GfK Verein, « une association à but non lucratif fondée en 1934 en vue de promouvoir les études de marché » et initialement reprise par RIA Novosti :
« [En Russie,] quant aux partis politiques, seuls 23% des sondés affirment leur faire confiance.
Il est à noter que cet indice n'est pas le plus bas d'Europe : la cote de confiance des partis politiques est de 18% en Pologne, de 12% en France et de 9% en Espagne et en Italie.
Le sondage fait ressortir une baisse de confiance dans les institutions financières. Si la cote de confiance dans les banques et les compagnies d'assurances se situe en Russie à hauteur de 41%, elle est de 36% en Allemagne, de 30% en Espagne et de 24% en Italie. (...)
Les données citées ci-dessus résultent d'un sondage effectué par l'agence à l'automne 2011 auprès de 28.000 personnes dans 25 pays du monde. »
En cette période de campagne électorale, voilà qui remet les pendules à l'heure.
J'ai toujours pensé que les gens qui votent ne le font que très peu par conviction, ou foi en tel ou tel parti mais, en réalité, en vertu du mot d'Aristote passé en proverbe : « Entre deux maux, il faut choisir le moindre » (Rhétorique).
Comment expliquer autrement qu'une bonne moitié des électeurs français, pourtant très largement opposés à l'immigration et révoltés par le libre-échange mondialisé, dont ils ont très clairement perçu les effets dévastateurs, continuent de voter alternativement pour des partis systémiques dont les différences s'amenuisent de plus en plus et qui, en tout cas, sont tous porteurs de ces deux catastrophes ?
20:11 Écrit par Boreas dans Crise, Politique, Propagande, Psychologie | Lien permanent | Tags : sondage, gfk verein, cote de confiance, partis politiques, france, élections, présidentielle, 2007, 2012, immigration, libre-échange, sarkozy, royal, partitocratie, abstention, fn, hollande, bayrou, révolution, arnaque | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
09/01/2012
« L'oligarchie des incapables », un livre indispensable
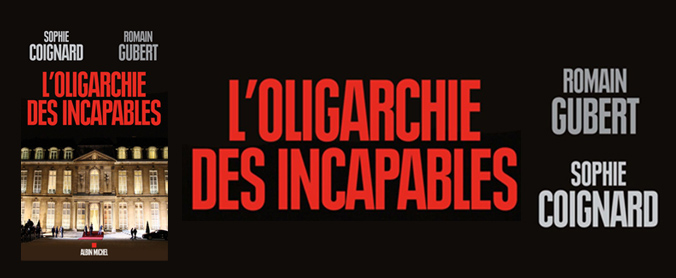
Passionnant entretien par Internet entre l'un des auteurs, Romain Gubert, journaliste au Point, et des lecteurs du journal 20 minutes :
« Pour les deux journalistes Sophie Coignard et Romain Gubert, des personnalités politiques monopoliseraient les plus hautes fonctions de la France, cumulant les privilèges et se servant de l'Etat pour aider leurs proches, fabriquer des lois sur mesure. En procédant ainsi, ces "représentants" se seraient mis à l'écart des citoyens, provoquant une déficience de pluralisme dans les centres décisionnaires du pays.
Et si le drame français se situait avant tout dans le mauvais fonctionnement de ses institutions et le comportement de ces élus ?
------------------
On voit dans les rapports de la Cour des Comptes, que la quasi totalité des subventions versées par l'Etat, l'ont été pour des opérations dont on n'a jamais vraiment vérifié l'opportunité et dont les résultats n'ont eux-mêmes quasiment jamais été vérifiés pour aucune d'entre elles ; ce ne serait pas grave s'il ne s'agissait pas chaque année et depuis des lustres, de dizaines de milliards d'euros. (...) J'ai l'impression que ces élus, toujours à la recherche de l'électorat et voulant montrer à tout prix qu'ils sont utiles à quelque chose, trouvent dans l'administration assez de bonnes âmes, désireuses elles-mêmes de se faire valoir. Et voilà comment se montent des projets fumeux, qu'on emballe soigneusement et qu'on met en place en se doutant souvent qu'ils n'auront, comme les précédents, quasiment aucun résultat. Êtes-vous d'accord avec cette façon de voir les choses ?
Effectivement, dans un pays qui consacre chaque année 56% de la richesse nationale aux dépenses publiques, il est indispensable d’évaluer celles-ci. Plutôt que de couper dans certaines prestations qui font le ciment de la société, il vaut mieux que chaque euro d’argent public soit dépensé avec efficacité. Les contrôles de la Cour des Comptes sont donc nécessaires et indispensables. Le problème, c’est que celle-ci a de moins en moins de moyens pour contrôler ce qui se fait en province. D’autre part, [les membres de] l’Inspection des finances, l’un des corps les plus prestigieux de l’Etat, composé de hauts fonctionnaires de talent sensés vérifier l’usage de la dépense publique, sont aujourd’hui de plus en plus tentés par le secteur privé. Ils quittent donc la haute administration après quelques années au service de l’Etat.
Les journalistes font partie du jeu, participent d'une certaine manière à cette oligarchie, dont vous parlez. Comment faites-vous pour la dénoncer tout en n'étant pas inquiétés dans vos activités au Point ? Est-ce à dire que l'oligarchie se fiche complètement d'être démasquée ou que la critique est encore en deçà de la réalité ?
10:42 Écrit par Boreas dans Crise, Politique, Propagande, Psychologie | Lien permanent | Tags : sophie coignard, romain gubert, l'oligarchie des incapables, élites, népotisme, concussion, cooptation, copinage | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
05/01/2012
Notre Dame de Paris est libérale

« Est-ce qu'il sait seulement que je le suis aussi, cet ahuri ? »
« Je suis libéral. La droite aujourd'hui ne l'est pas. La gauche doit se réapproprier avec fierté le mot et la chose. Si les socialistes du XXIe siècle acceptent enfin pleinement le libéralisme, s'ils ne tiennent plus les termes de concurrence ou de compétition pour des gros mots, c'est tout l'humanisme libéral qui entrera de plein droit dans leur corpus idéologique. »
Bertrand Delanoë, dans De l'audace (2008) - Source
Au fait, son autre surnom, c'est Embrayage.
20:58 Écrit par Boreas dans Economie, Politique | Lien permanent | Tags : bertrand delanoë, libéral, droite, gauche, libéralisme | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Révolution = par-delà « droite » et « gauche »

Orwell avait raison... Voilà l'ennemi.
Paul Jorion a encore vu le loup, mais sans le reconnaître (lisez bien sa dernière phrase) :
« Vous écrivez, dans "La guerre civile numérique" (Editions Textuel, 2011), que nous sommes dans une "situation prérévolutionnaire". N’est-ce pas exagéré ?
Non, le parallèle peut être fait avec 1788 : tout le monde a bien analysé la situation, mais la classe dirigeante reste "assise sur ses mains", comme on dit en anglais, elle espère que les choses vont s’arranger d’elles-mêmes. C’est criminel.
Vous pensez donc que les gens vont se révolter ?
Oui… Les mouvements d’indignés sont des protestations qui restent assez domestiquées. Dans certains pays, les gens réagissent en fonction de leur degré de souffrance : ils manifestent un peu quand ils souffrent un peu, et davantage s’ils souffrent plus... Mais en France, on n’a pas cette tradition. On encaisse jusqu’à un certain seuil, et puis ça explose.
Et vous pensez que nous y sommes ?
Oui, on arrive à un seuil. Cela se manifeste de manière indirecte, dans le nombre de gens qui se disent prêts à voter pour le Front national. Je discutais l’autre jour avec un chauffeur de taxi : il m’a fait une analyse de la situation qu’on dirait d’extrême gauche, et à la fin il m’a expliqué qu’il allait voter pour Marine Le Pen… Cela n’avait pas de sens au niveau politique, mais c’était sa manière à lui d’exprimer son indignation. »
« Pas de sens au niveau politique » ! Les bras m'en tombent, devant pareil aveuglement.
Pourtant, l'argumentaire pour démolir, idéologiquement, tant la « droite » que la « gauche », on le trouve, par exemple, dans les bouquins de Michéa.
Cet argumentaire revient à dénoncer, chez les uns et les autres, les mêmes aberrations fondées sur les mythes du progrès et de la croissance, et le même désintérêt pour le peuple au nom de principes uniformément libéraux, au plan philosophique, bien que d'apparences différentes.
C'est cela qui étonne Jorion, désarçonné par ce qu'il appelle une « analyse qu'on dirait d'extrême gauche » chez son chauffeur de taxi prêt à voter MLP.
16:51 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Histoire, Politique, Stratégie | Lien permanent | Tags : paul jorion, révolte, révolution, seuil, souffrance, protestations, vote, fn, marine le pen, jean-claude michéa, progrès, croissance, libéralisme, droite, gauche, question sociale | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
03/01/2012
« Occupy » veut sortir des réseaux sociaux contrôlés

Je suis tombé sur cet intéressant article du 28 décembre 2011 :
« Occupy Wall Street ne veut plus occuper Facebook et crée son réseau alternatif
Des membres du mouvement Occupy Wall Street développent un réseau social libre et distribué, craignant la mainmise des autorités sur Facebook et Twitter.
Le mouvement Occupy Wall Street (OWS) doit beaucoup aux réseaux sociaux, tout comme le Printemps arabe ou les Indignés européens.
Il essaie maintenant de créer sa propre plate-forme sociale libre, distribuée et hors d’atteinte des autorités.
Les Facebook et autres Twitter ont pourtant permis à ces militants de s’organiser, et de très rapidement populariser leurs causes. Au point que les soulèvements dans les pays arabes aient été baptisés "Révolutions Facebook".
Mais ces services sont contrôlés par des entreprises américaines, qui ont l’obligation de collaborer avec les autorités.
Les esprits se sont particulièrement échauffés la semaine dernière, quand il a été révélé que Twitter était sous le coup d’une injonction d’un procureur du Massachussetts. Il souhaite obtenir toutes les informations possible sur le compte @OccupyBoston, une branche locale d’OWS, et d’autres comptes associés.
De quoi donner un sérieux coup d’accélérateur aux différentes plates-formes développées par et pour les activistes, comme Global Square ou le Federated General Assembly qui tente de rassembler la multitude de réseaux locaux du mouvement Occupy.
Le magazine Wired explique que la principale différence entre ces réseaux libres et distribués avec Facebook ou même Diaspora, est que les membres ont besoin de pouvoir se faire confiance. Du coup, il n’est pas possible de s’y inscrire librement : il faut nécessairement y être invité.
Contrairement à Facebook, ces réseaux ne sont pas conçus pour partager ses propres expériences, mais pour collaborer sur des projets de groupe. Par exemple, plutôt qu’un fil rassemblant toutes les actualités de ses contacts, un utilisateur voit les avancées des travaux de ses groupes.
Chaque groupe décide collectivement quelles contributions sont mises en avant, sur le modèle des sites d’actualité sociaux (Digg, Reddit…). Pour faire émerger les consensus et les opinions intéressantes.
Enfin, la confidentialité est fondamentale : la plupart des contributions sont réservées au groupe de travail concerné, à part celles qui sont destinées à être partagées avec le grand public, comme les communiqués de presse ou les synthèses.
Mais les technologies développées pour ces solutions, qui doivent être multi-plates-formes, multi-formats et reposent sur les standards du Web sémantique, pourront s’appliquer bien au delà des mouvements militants.
Ces technologies de collaboration décentralisées seraient même idéales pour les PME, souligne Ed Knutson, un programmeur travaillant sur le projet Global Square.
"Je pense que n’importe quel type de groupe de petite ou moyenne taille, ou une équipe avec une personne dans 8 villes différentes, pourraient l’utiliser pour collaborer" explique-t-il à Wired.
"Tout propriétaire d’une petite ou moyenne entreprise fait partie des 99%", ajoute-t-il d’ailleurs, toujours militant.
Il pense qu’une première version de Global Square sera mise en ligne en janvier. »
Ces gens sont vraiment loin d'être bêtes.
Nous ferions bien de nous en inspirer, vous ne trouvez pas ?
16:59 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Politique, Stratégie | Lien permanent | Tags : occupy, ows, etats-unis, facebook, twitter, réseaux sociaux, contrôle, autorités | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
01/01/2012
Bonne année 2012, camarade !

00:00 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Identité, Philosophie, Politique, Psychologie, Société | Lien permanent | Tags : voeux, 2012, le guerrier silencieux, walhalla rising | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
31/12/2011
« Salut public », un nouveau journal dissident

Si j'ai bien compris, le mois prochain, un média alternatif va fleurir en kiosque, avec le titre ô combien d'actualité de « Salut public ».
Je vous livre en avant-première, avec l'autorisation de l'auteur que je remercie, quelques extraits de « Dette publique, à qui profite l'aubaine », un excellent article sur la loi de 1973 :
« (...) Pendant des années, les économistes de Bercy ont vendu aux Français le concept de “dette soutenable”. Ainsi, l’endettement financé par les marchés financiers était-il réputé soutenable, donc sans incidence négative, si l’égalité suivante était réalisée : Tt = it + gt, avec T le niveau du taux d’intérêt consenti à la France, i la croissance du PIB, et g le taux nominal d’inflation (t représente l’année en cours).
Sans trop entrer dans la technique, sachant que l’inflation est strictement encadrée par les autorités monétaires de Francfort (BCE), le déterminant principal de la soutenabilité de la dette publique est, par conséquent, la croissance du PIB.
Que se passe-t-il en période de croissance faible, plate, voire négative, comme on l’observe en ce moment et pour les semestres à venir ? Très simple : la dette devient mécaniquement “insoutenable”, ce qui signifie qu’elle s’accumule chaque année et que son service (principal et intérêt) devient de plus en plus lourd pour les finances publiques.
La charge de la dette, qui ne concerne que les intérêts remboursables sur une année civile, est même devenue, pour la première fois en 2010, le premier poste budgétaire de notre pays. (...)
La dette publique n’est pas perdue pour tout le monde et le malheur des Français fait le bonheur des banques.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
La loi Pompidou-Giscard s’inscrit dans le droit fil de la mise en place, dès la sortie de la deuxième guerre mondiale, d’un cadre économique global, d’inspiration américaine, tendant à supprimer toutes les entraves à la circulation des capitaux, des biens et services, et des personnes.
Ce cadre devait permettre à l’économie des USA de capitaliser sur ses avantages relatifs par rapport à une Europe ruinée et fortement débitrice, à la sortie du conflit mondial.
Les institutions du consensus de Washington (FMI, OMC, Banque Mondiale) d’une part, et le processus d’intégration européenne d’autre part, participaient de cette dynamique.
Les autorités françaises de l’époque contribuèrent de manière spectaculaire à la mise en oeuvre du volet “dérégulation financière” du dispositif, à l’occasion de ce que certains nommeront plus tard le “Consensus de Paris”.
Concomitamment, les accords de la Jamaïque, en 1976, ont de leur coté mis fin au système de change fixe et au rôle de l’or dans le système monétaire international.
Dans les années 1980, sous l’administration Reagan, on assistera à l’explosion des produits dérivés et, sous Clinton, la loi Gramm-Leach-Bliley mettra un terme au Glass-Steagall Act qui séparait les activités de banque de dépôt et de banque d’investissement, bouleversant un ordonnancement prudentiel remontant à 1933.
Ainsi, un cadre d’échange international était donc parachevé, afin de permettre une progression inédite du volume des activités banco-financières :
- Financement des dettes publiques par les marchés, banques en tête, assurant des profits sécurisés sans précédent,
- Massification des produits dérivés (diversité des titres collatéralisés, CDS, etc.), favorisant la titrisation d’innombrables classes d’actifs,
- Désintermédiation financière,
- Dématérialisation de la plupart des marchés financiers, assurant un fonctionnement ininterrompu et fluide de ceux-ci,
- Plus largement, dérégulation généralisée, posée comme principe et horizon indépassable de la prospérité des nations, cette antienne étant confortée par un corpus d’universitaires américains et européens, d’économistes utiles et de médias coopératifs…
Et demain, quelle perspective pour nous et quel avenir pour nos enfants ?
Pour en revenir plus spécifiquement à la loi de 1973, non seulement elle nous a endetté artificiellement et au-delà du raisonnable, de manière particulièrement insoutenable dans notre contexte économique actuel, mais elle a contribué à populariser l’idée qu’une politique économique visant à obtenir et à maintenir, entre autres choses, une notation AAA permettant d’emprunter à +/- 3%, était un objectif louable en tant que tel, alors qu’il s’agit seulement des “moins pires” conditions d’emprunt.
En définitive, rien n’interdirait, en modifiant le traité de Lisbonne, d’envisager un financement mixte de notre dette publique, combinant le recours aux marchés et l’intervention d’une banque centrale, quel que soit l’échelon retenu, national ou communautaire.
La loi de 1973 n’est pas la mère de tous nos maux, elle n’est qu’une brique d’un ensemble plus vaste dont les fondements remontent à l’après-guerre. C’est un symptôme, pas une cause, même si, intrinsèquement, elle produit des effets délétères dont nous observons les manifestations à répétition.
Dans tous les cas, ce qui a été patiemment tissé par la volonté combinée de puissances politiques de plusieurs blocs, ne saurait être détricoté qu’en mobilisant, dans un temps long, les mêmes participants et même au-delà, la mondialisation ayant fait émerger d’autres aires de prospérité économique, dans l’optique de définanciariser le capitalisme ultra-libéral qui prévaut à l’échelle mondiale.
Actuellement, la seule enceinte politique ayant un tant soit peu ce potentiel est le G20. Or, il semble évident que les divergences d’intérêts de court terme, l’asymétrie des conditions économiques entre les différents acteurs, tant quantitative et qualitative que calendaire, ne favorisent aucunement cette perspective. »
15:39 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Politique | Lien permanent | Tags : médias, salut public, loi de 1973, pompidou, giscard, dette, aubaine, finance, banques, consensus de washington, etats-unis, produits dérivés, marchés financiers, notation aaa, g20 | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
